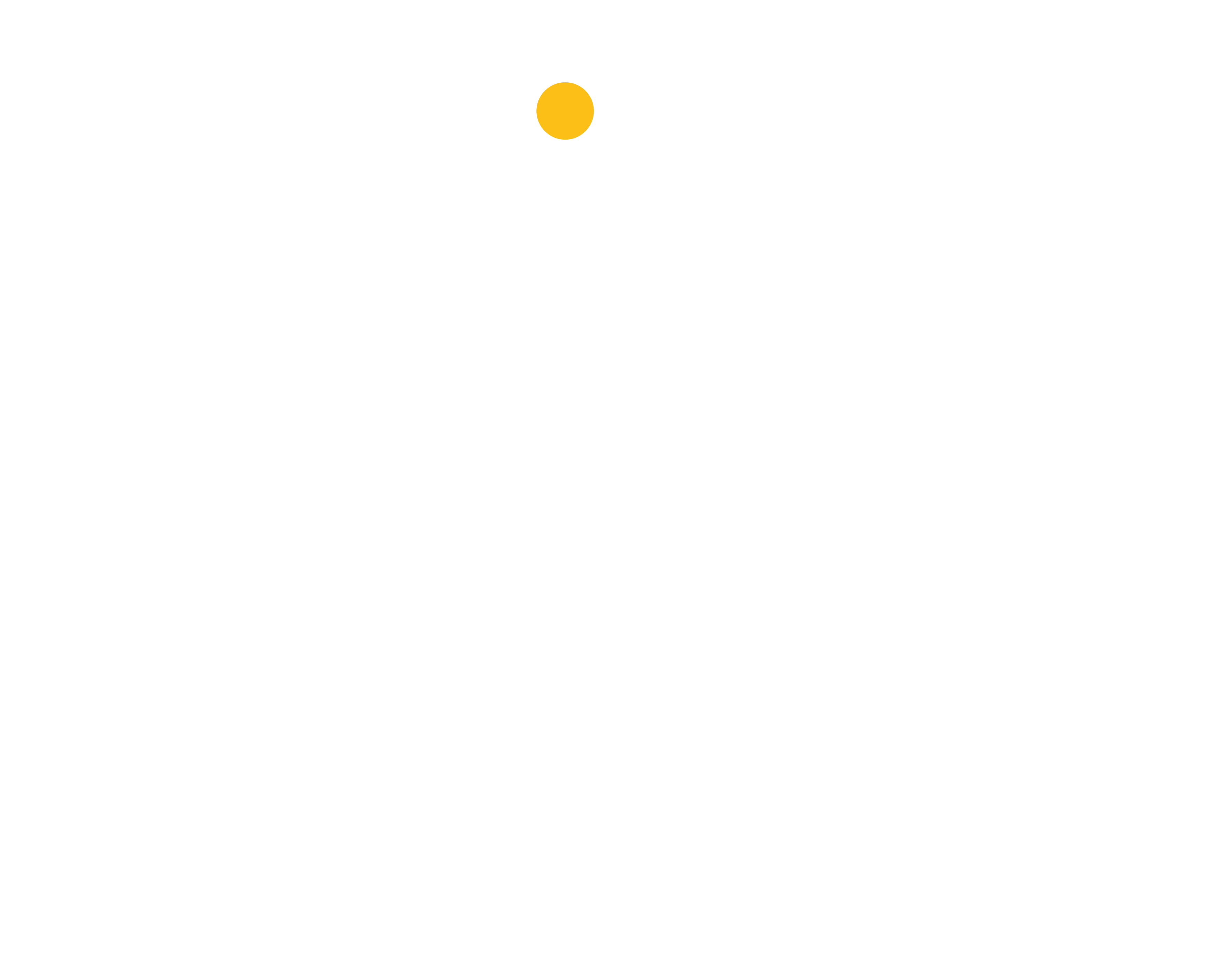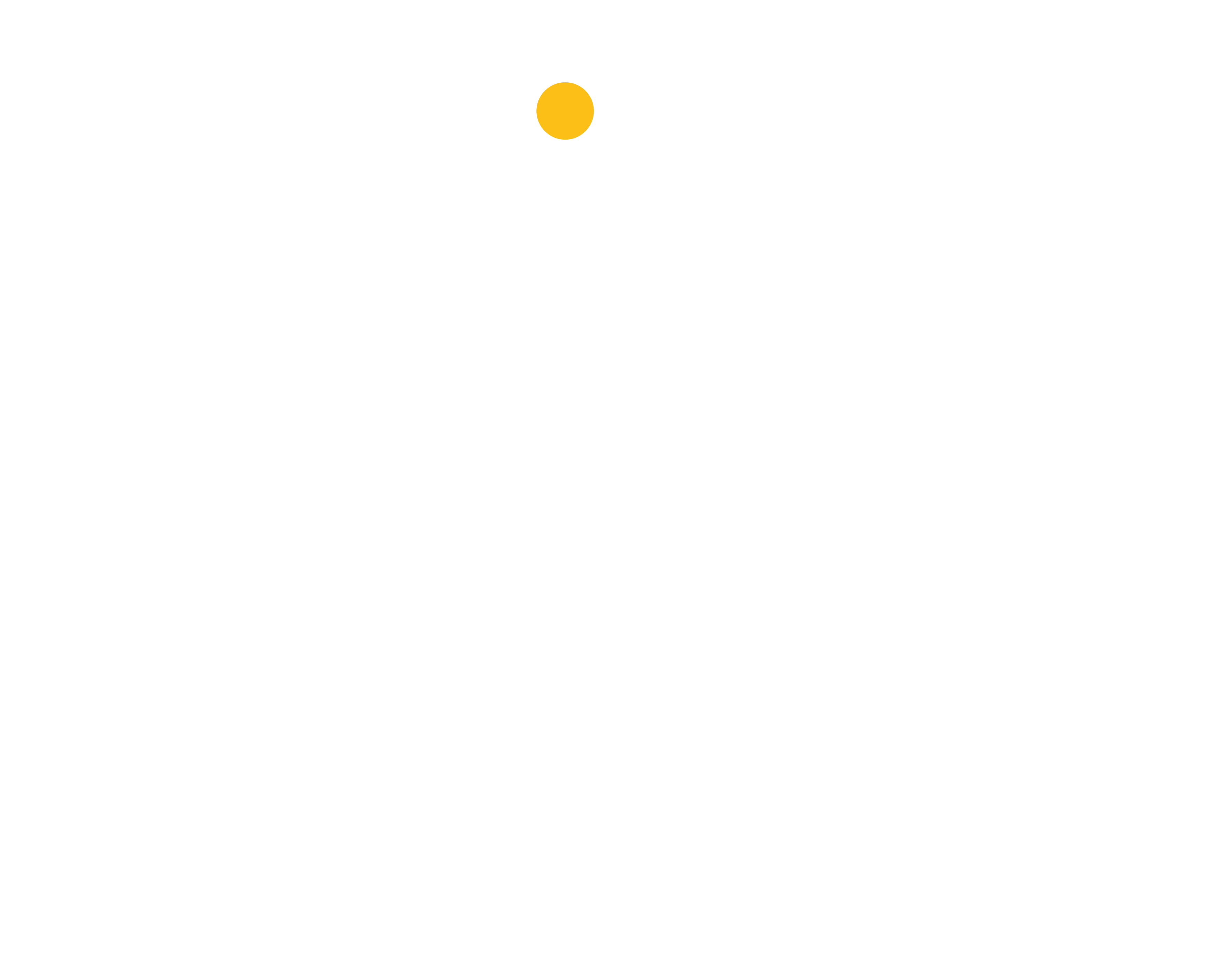François Jarret, Seigneur de Verchères (1632-1700)
François Jarret naquit en 1632 dans la paroisse de Saint-Chef, archevêché de Vienne en Dauphiné, fils de Jean Jarret et de Clauda de Pécoudy. Il arrive à Québec avec le régiment de Carignan-Salières en 1665. François-Xavier est enseigne dans la compagnie de M. Antoine Pécoudy de Contrecoeur, son oncle. Lorsque le régiment de Carignan, après des périodes guerroyantes fut rappelé en France en 1669, l’intendant Jean Talon offrit des terres à ceux qui voulaient demeurer en Canada et s’y établir. Quatre cents officiers et soldats acceptèrent cette offre : les officiers reçurent du roi des concessions de terre en seigneuries.
Monsieur de Verchères s’était marié à l’Île d’Orléans, le 7 septembre 1669 avec Marie Perrot, fille d’un des principaux cultivateurs de l’île. Le couple se mit vite à l’ouvrage sur leur seigneurie de Verchères avec les quelques censitaires qu’il avait déjà recrutés. Le manoir qu’ils élevèrent ressemblait sans doute à tous ceux de l’époque. Une palissade de 15 pieds de haut formait un carré d’environ un arpent de côté, qui protégeait la maison du Seigneur, les granges, les écuries et le dépôt de munitions. Le côté qui regardait le fleuve avait une porte au milieu ; les trois autres faces étaient protégées par un fossé de 10 pieds de largeur, où l’on avait canalisé les eaux de la rivière Jarret. Ce fort était assez vaste pour loger au besoin la population et les bestiaux. Il était muni d’un canon et de quelques fusils.
François Jarret était déjà établi à Verchères en 1670, année où il fit la demande d’une seigneurie. Le 28 octobre 1672, le roi lui accordait : « une demye lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve Saint-Laurent, depuis la concession du Sieur de Grandmaison en descendant vers les terres non concédées jusqu’à celle du Sieur de Vitrez … »
Monsieur de Verchères avait prouvé son courage et son ardeur à poursuivre le développement de sa seigneurie, et quelques années plus tard il reçut une nouvelle concession, en arrière de la première, ce qui étendait son domaine des rives du Saint-Laurent jusqu’à celles du Richelieu. Toutefois les Iroquois qui remontaient du lac Champlain par le Richelieu pour venir attaquer la colonie, touchaient chaque fois à Verchères. Les habitants, éloignés des places fortes de Chambly, Sorel et Montréal, étaient sans cesse sur le qui-vive. Quand le laboureur s’en allait aux champs, avec ses outils, le mousquet sur l’épaule, il fallait des guetteurs pour jeter l’alarme en cas de danger. En cas de surprise, plusieurs étaient tués ou faits prisonniers.
Malgré la menace continuelle, sur la seigneurie de Verchères il y avait déjà plus de cent arpents en culture et 12 familles établies au moment du recensement officiel de 1681, dont :
- François Jarret et Marie Perrot et 5 enfants
- André Jarret et Marie Anthiaume et 2 enfants
- Toussaint Lucas et Marguerite Charpentier (sans enfants)
- Mathieu Binet et Anne Leroy et 3 enfants
- Adrien Ponce (sans femme ni enfants)
- Jean Plouf et Madeleine Quilleboeuf et 2 enfants
- Pierre Joffrion et Marie Briot et 6 enfants
- André Balsac et Françoise Loussy et 5 enfants
- François Chagnon et Catherine Charron (sans enfants)
- Jean Charlo et Jeanne Mansion et 5 enfants
- Pierre Boisseau et Anne Hébert (Foubert) et 5 enfants
- Pierre Chicoine et Madeleine Chrestien et 5 enfants
En 1690, une attaque fut repoussée par l’intrépide dame de Verchères, Marie Perrot. Assaillie dans le fort en l’absence de son époux, elle se défendit pendant deux jours, avec une bravoure et une présence d’esprit qui aurait fait honneur à un vieux guerrier.
En 1694, M. de Verchères fut nommé lieutenant. Il mourut le 26 février 1700.
La paix s’installe en 1701entre les Français et les Iroquois. Les colons peuvent s’établir plus nombreux et peuvent vivre et cultiver à l’aise. La population de Verchères augmente.
Source : Comité de Toponymie et d’histoire de Verchères
Ludger Duvernay, (1799-1852)
Très talentueux en matière d’écriture il fut aussi un ardent défenseur du patriotisme français. À partir de 1817, il fonde plusieurs journaux. Il acquiert le journal La Minerve en 1827. Ce dernier sera le plus éloquent. Il joindra un peu plus tard M. Louis-Joseph Papineau, illustre patriote et devient l’un des chefs du parti populaire. En 1834, il conçoit l’idée d’une fête groupant les Canadiens français. Vers 1837, des troubles sociaux éclatent et il doit s’exiler aux États-Unis. De retour au pays en 1842, il rétablit La Minerve et réorganise la Société Saint-Jean Baptiste. La fête des Canadiens français prend de l’ampleur au-delà des espérances de Duvernay et devient la Fête de la St-Jean, notre Fête nationale.
En 1834, il conçoit l’idée d’une fête groupant les Canadiens français. Vers 1837, des troubles sociaux éclatent et il doit s’exiler aux États-Unis. De retour au pays en 1842, il rétablit La Minerve et réorganise la Société Saint-Jean Baptiste. La fête des Canadiens français prend de l’ampleur au-delà des espérances de Duvernay et devient la Fête de la St-Jean, notre Fête nationale.
Nous pouvons admirer son mémorial dans le parc Jean-Marie-Moreau se trouvant en face de la mairie de Verchères.
Calixa Lavallée, (1842-1891)
Ayant fait des études musicales à Montréal, à Québec et à Paris, il était instrumentiste et compositeur. Au début de 1864, il s’installe à Montréal comme professeur de musique. Après de multiples voyages entre les États-Unis et le Canada, en 1880 on lui demande de mettre en musique le poème d’Adolphe Routhier qui servira d’hymne national. Le « Ô Canada » fut exécuté pour la première fois le 24 juin 1880. Calixa Lavallée composera plusieurs autres musiques.
Joseph Coulon de Villiers, Sieur de Jumonville (1718-1754) et Louis Coulon de Villiers (1710-1757)
Tous les deux, neveux de Madeleine de Verchères. Joseph Coulon de Villiers fut mandaté en 1754, comme officier de la garnison du fort DuQuesne à Pittsburgh (occupé alors par les Français), pour y assurer le retrait des Anglais. Le 28 mai de la même année, sur les rives de l’Ohio, alors que le Sieur De Jumonville faisait la lecture d’une sommation au colonel Georges Washington, il fut atteint d’une balle à la tête et en mourut. Un mois après la mort de son frère, Louis Coulon de Villiers et ses hommes ont vaincu au fort Necessity, les Anglais ayant toujours à leur tête Georges Washington. Suite à cette victoire, Louis Coulon de Villiers fut nommé Premier Chevalier de Saint-Louis en 1757.
Bernard-Landry, (1937-2018)
Bernard Landry était un avocat, professeur et homme politique québécois, né le 9 mars 1937 à Saint-Jacques et mort le 6 novembre 2018 à Verchères où il a vécu les 30 dernières années de sa vie.
Il adhère au Parti québécois dès sa fondation et n’abandonnera jamais sa famille politique. Député et ministre de 1976 à 1985, puis de nouveau à partir de 1994, Bernard Landry devient le 2 mars 2001 chef du Parti québécois et le 28e premier ministre du Québec. Défait lors des élections de 2003, il démissionne de ses fonctions de chef du parti, de chef de l’opposition officielle et de député deux ans plus tard, en 2005.
Bernard Landry aura marqué le Québec pendant plus de cinquante ans. Il laissera en héritage à ses concitoyens une économie moderne adaptée au XXIe siècle, des programmes sociaux novateurs et un traité devenu exemplaire dans le domaine de la reconnaissance des Premières Nations, la Paix des Braves. Il quitte la direction du Parti québécois en 2005 pour reprendre ce qu’il considérait comme la plus noble des fonctions, l’enseignement.
Prix et médailles
- Médaille René-Lévesque (16 mai 2019, à titre posthume)

- Médaille de l’Université du Québec à Montréal (2014)
- Prix Pierre-Bourgault (2008)
- Patriote de l’année de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (2006)
- Prix Louis-Joseph-Papineau (2005)
Le 24 juin 2022, on inaugure la Place Bernard-Landry à Verchères où on peut admirer un buste à son effigie.